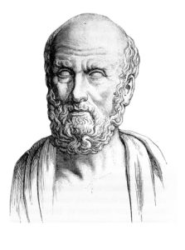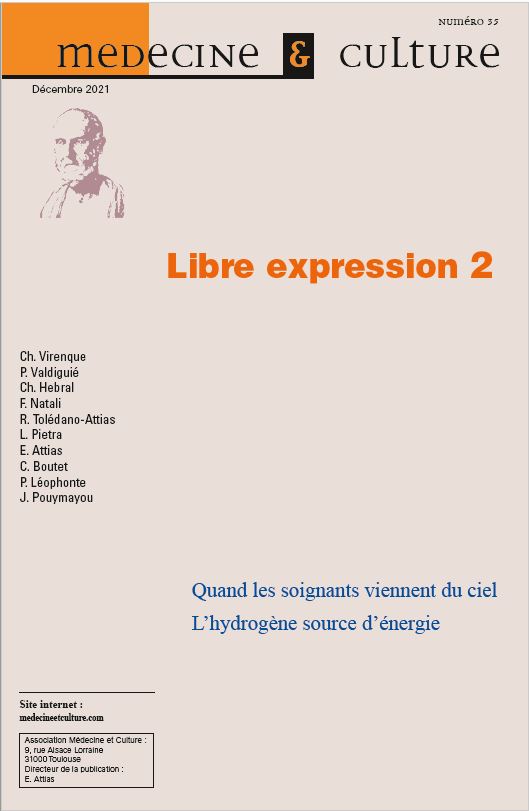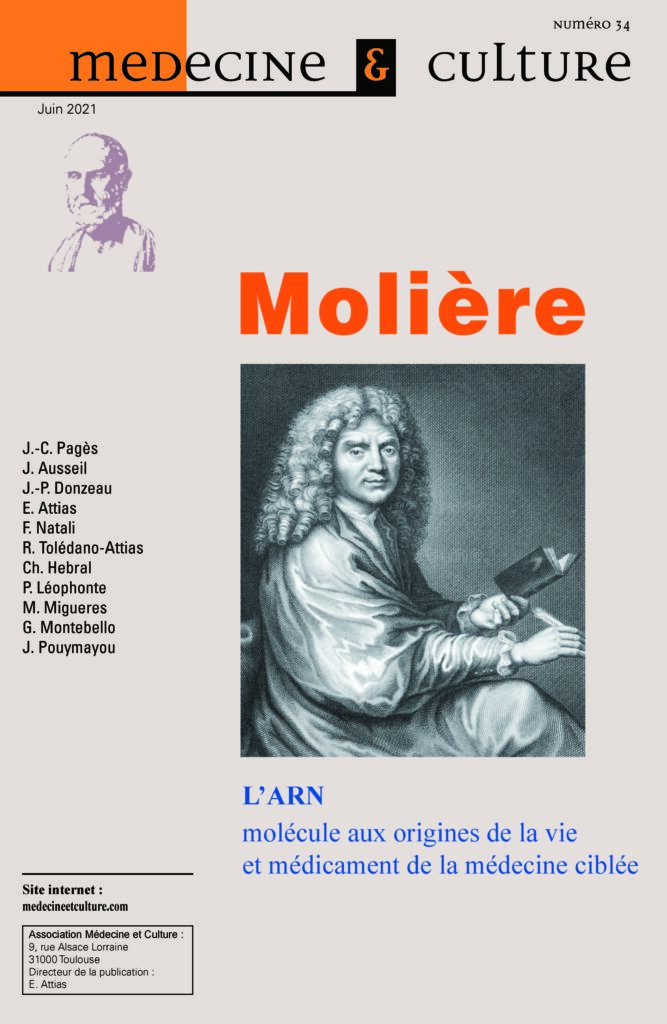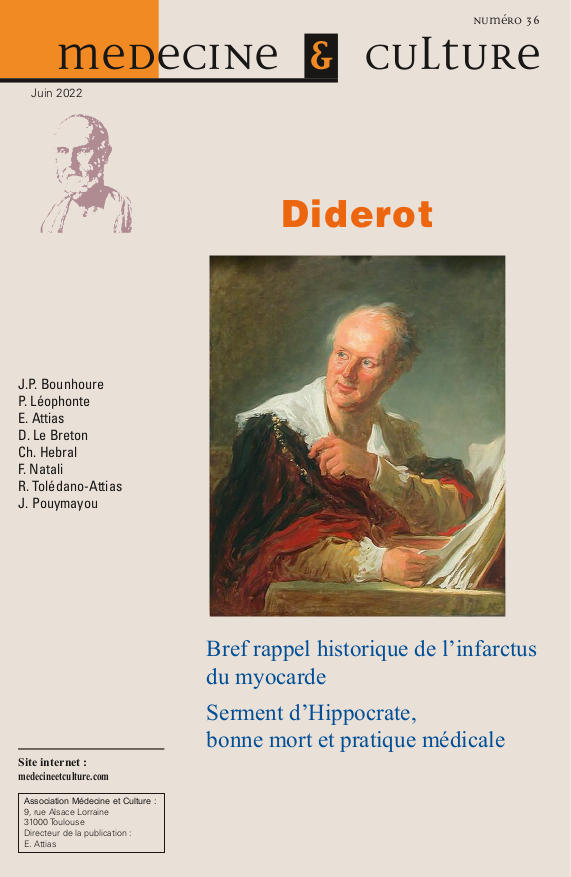
Editorial – revue n°36
Alors que l’angine de poitrine parfaitement décrite par Heberden en 1772 avait suscité au cours des décennies suivantes de nombreuses publications sur sa pathogénie, l’infarctus du myocarde fut pratiquement méconnu jusqu’à la fin du XIXe siècle. Le traitement recommandé par les guidelines, des experts des Sociétés savantes, bien codifié, conseillant la prise en charge très rapide et le traitement par thrombolyse ou cardiologie interventionnelle des infarctus, doit être considéré comme un des grands progrès de la cardiologie actuelle.
A la fin de sa vie, René Leriche, grand chirurgien du siècle passé, confiait porter en lui un petit cimetière où il faisait de temps en temps oraison. Aux marges des joies, des succès remportés contre la maladie et des relations humaines qui ont enrichi sa vie professionnelle, il revit ce qu’elle put avoir d’inaccompli. Denis Diderot, connu de son vivant comme le maître de l’Encyclopédie, reconnu pour son érudition et son esprit critique, édifia, entre philosophie et littérature, roman et théâtre, une œuvre riche, complexe, originale, représentative du siècle des Lumières. Sa modernité ressort de son goût pour les idées neuves, de sa curiosité pour les sciences, de la hardiesse de sa pensée, ce qui n’a pas manqué de lui valoir quelques déboires avec les autorités.
Editorial – revue n°35
L’année s’achève avec ce satané virus qui perturbe notre quotidien, freine nos projets, nos rencontres et nos loisirs. Le nombre de contaminations explose encore et, parmi les patients infectés, 90% ne sont pas vaccinés. Comment éviter cette propagation ? Doit-on donc rendre la vaccination obligatoire ? Cette situation angoissante n’a que trop duré ! Heureusement que la lecture et l’écriture nous accompagnent.
La médecine héliportée, née en 1950, lors de la guerre d’Indochine, adaptée vingt ans plus tard à la médecine civile par des médecins hospitaliers de Toulouse, au sein de l’arsenal des techniques de médecine d’urgence, elle occupe aujourd’hui, en France, une place prépondérante.
L’énergie de nos cellules vient aussi de l’hydrogène. L’hydrogène décarboné sera utilisé dans un futur proche et l’avenir est dans le développement de réacteurs civils à fusion d’hydrogène.
Dans la partie culturelle, nous avons opté pour une libre expression. Les confrères et amis que vous lisez régulièrement traitent le sujet de leur choix.
Bonne et heureuse année 2022
N°35 Médecine & Culture
N°34 Médecine & Culture
Editorial – revue n°33
Personne n’avait prévu qu’une pandémie – de Covid-19 – allait tout bouleverser. Nous vivons une période étrange, inattendue et déconcertante, une véritable catastrophe ! Il y a des morts tous les jours et nous sommes préoccupés par le risque d’infection, menacés par un ennemi insaisissable, dangereux qui met notre vie en danger. Nous devons rester prudents et respecter toutes les mesures obligatoires : le confinement qui nous éloigne des proches et du monde, le lavage répétitif des mains, la distanciation, le masque qui cache notre visage et nous irrite mais que nous portons par nécessité afin de nous protéger d’une éventuelle contamination
Le masque risque de rompre notre lien avec le monde extérieur en nous dépossédant d’une partie importante de notre visage. Il nous soustrait au regard d’autrui et dissimule ainsi une part de notre identité. Mais, pour Emmanuel Levinas « le visage ne s’identifie pas uniquement à la figure. Il nous rappelle notre fragilité, notre exposition à la maladie et à la mort mais n’exclut pas que l’autre ait un visage, c’est-à-dire qu’il soit singulier, porteur d’une fragilité, d’une mortalité et qu’il invoque notre responsabilité ».
Dans un extrait d’Éthique et infini, E. Lévinas écrit :
« Je pense […] que l’accès au visage est d’emblée éthique. C’est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c’est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux ! Quand on observe la couleur des yeux, on n’est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c’est ce qui ne s’y réduit pas… Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer » .
Pour David Le Breton, le visage est le lieu de la reconnaissance de l’autre et où l’on doit aussi répondre de ses actes. Sans déligitimer le port du masque dans le contexte de cette pandémie, le prix à payer semble lourd. Il nous défigure et altère le lien social car chacun perçoit l’autre comme un danger, une menace pour sa santé. Il risque aussi de nous libérer de toutes nos responsabilités. Mais il ne mettra pas à mal la convivialité. « Certes, nos rites d’interactions sont bouleversés, mais nous en inventons d’autres. Nous gardons aussi un immense désir de retrouver une liberté de mouvement mais surtout de sortir indemne de cette crise sanitaire ».
Tous ces changements perturbent actuellement notre vie sociale et familiale. L’ambiance est anxiogène et les rapports humains ne sont plus les mêmes. Les jours passent et se ressemblent. L’optimisme est devenu un besoin !
Bonne et heureuse année 2021
1 Corine Pelluchon, “Quand on ne rencontre que des gens masqués, on a le sentiment d’être seul au monde”, Mis en ligne le 28/05/2020.
2 Emmanuel Lévinas (1906-1995), Ethique et infini (1982)